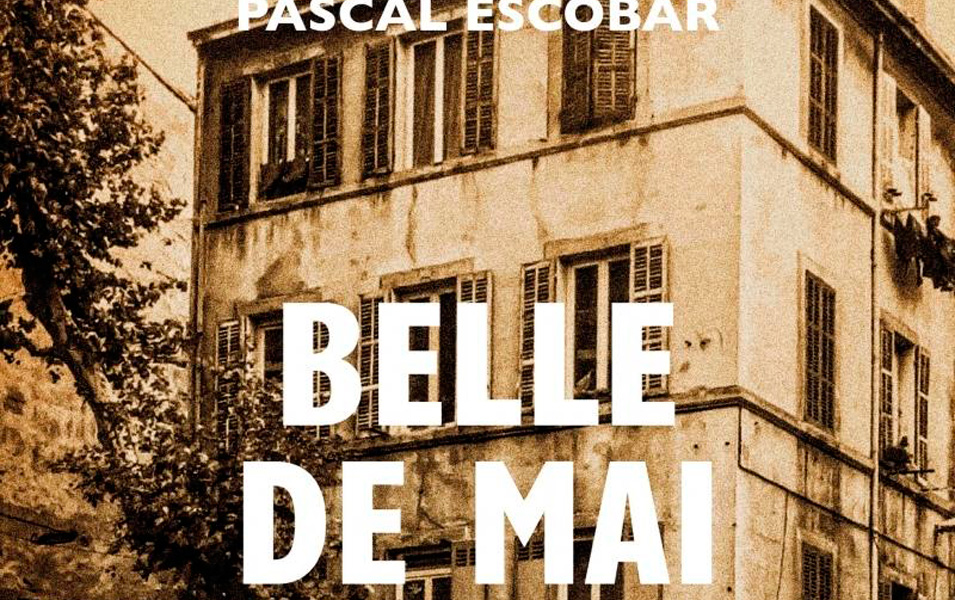
Millefeuille | Belle de Mai de Pascal Escobar
Auprès de ma Belle de Mai
Guitariste au sein d’une multitude de groupes emblématiques de la scène rock marseillaise des années 2000, Pascal Escobar a définitivement tourné la page musicale. Son premier roman, publié aux éditions Le Mot et le reste, se veut une exploration de la topographie sociale de la ville aux 111 quartiers. Direction la Belle de Mai, un des quartiers les plus pauvres d’Europe, pour ce premier volet d’une trilogie à venir.
 Emblème de rébellion, le blouson de cuir est pour tout rocker une manière de signifier son appartenance à un clan, mais « le cuir » est aussi une seconde peau qui fait office de bouclier entre soi et le monde extérieur. Avec le temps, la carapace du rocker se fissure, le cuir se fendille. On se souvient des incartades de Pascal Escobar dans Dig It !, le fanzine dans lequel il signait des chroniques déjantées dans une veine gonzo que n’aurait pas reniées Hunter S. Thompson. En 2019, à l’occasion de la sortie du volume 2 de Histoire du rock à Marseille, il nous confiait avoir fait le tour du rock’n’roll et de ses composantes mortifères. Après un ultime concert, les guitares sont mises au rebut ; le cuir se fend pour de bon. Il abandonne le rock pour se consacrer à l’écriture, comme on quitte quelqu’un qu’on a aimé, sans regarder en arrière.
Emblème de rébellion, le blouson de cuir est pour tout rocker une manière de signifier son appartenance à un clan, mais « le cuir » est aussi une seconde peau qui fait office de bouclier entre soi et le monde extérieur. Avec le temps, la carapace du rocker se fissure, le cuir se fendille. On se souvient des incartades de Pascal Escobar dans Dig It !, le fanzine dans lequel il signait des chroniques déjantées dans une veine gonzo que n’aurait pas reniées Hunter S. Thompson. En 2019, à l’occasion de la sortie du volume 2 de Histoire du rock à Marseille, il nous confiait avoir fait le tour du rock’n’roll et de ses composantes mortifères. Après un ultime concert, les guitares sont mises au rebut ; le cuir se fend pour de bon. Il abandonne le rock pour se consacrer à l’écriture, comme on quitte quelqu’un qu’on a aimé, sans regarder en arrière.
Avec ce roman noir, premier opus d’une trilogie sur les quartiers marseillais, le natif de Saint-Henri embarque le lecteur dans les tréfonds de la Belle de Mai. Un quartier au nom si doux où, il y a quelques siècles de cela, de riches Marseillais venaient l’été en villégiature s’abreuver dans ses guinguettes. Plus tard, des populations immigrées, notamment les Italiens, en firent leur lieu de résidence. Aujourd’hui, alors que la gentrification avale la ville comme un bulldozer, la Belle de Mai est restée sur le bas-côté, en dépit de sa Friche culturelle ou de ses studios de cinéma. C’est un des quartiers les plus pauvres d’Europe, dans lequel les logements insalubres loués par des marchands de sommeil côtoient les squats sordides, seuls lieux d’accueil pour de nombreux migrants tant la puissance publique fait défaut. Ces « primoarrivants », comme les appelle Escobar, n’ont rien de commun avec les nouveaux habitants dont la Mairie aime à se gargariser. Ni Parisiens, ni jeunes actifs en quête d’un mode de vie californien, ces arrivants-là affluent de l’autre rive de la Méditerranée et sont pour nombre d’entre eux des mineurs isolés. De plus en plus nombreux, les places dans les centres d’hébergement d’urgence insuffisantes pour les accueillir, ils sont condamnés à errer dans les rues, proies faciles pour des gangs sans foi ni loi. Une catastrophe humanitaire mise en lumière par Pascal Escobar qui, ce faisant, s’éloigne des poncifs du polar. C’est dans cet écosystème que l’auteur fait évoluer son héros, Stanislas Carrera, un éducateur auprès du juge pour enfant reconverti en détective privé. La quarantaine sympathique, ancien batteur dans un groupe de metal, il est adepte du régime alimentaire italo-américain (pizzas et burgers) et affectionne un bon whisky en écoutant Johnny Cash sur sa platine vinyle. L’intrigue se noue autour de la disparition de Fuad, un adolescent dont le frère a commis un crime sordide : il a poignardé une femme à la sortie du métro. Parmi les personnages qui gravitent autour de cet anti-héros bien plus complexe qu’il ne semble l’être de prime abord, un aréopage masculin peu glorieux : Fruits Légumes, le cousin, qui après avoir fait fortune en vendant des kebabs, a fait de son alimentation un florissant point de deal ; Guendouzi, le commissaire de police qui fait montre d’un racisme très ordinaire ; Rossi, le psychologue sexiste et pervers avec qui il partage ses bureaux.
Le récit se déploie dans une profonde noirceur jusqu’à son climax, une chorégraphie de violence barbare qui révèle la part d’ombre du narrateur. Cette noirceur ambiante est, par endroits, contrebalancée par la solarité de la cité phocéenne qui, polar marseillais oblige, est un personnage à part entière du roman. Sous l’œil du détective, des pans entiers d’artères dévastées défilent comme dans un film : « Marseille est un vaisseau qui sombre emportant avec lui l’amertume de tout ce qui aurait pu être mais n’a pas été à cause de bourgeois encore plus dégénérés que ceux d’ailleurs », constate Carrera, livrant ainsi un regard lucide sur sa ville. Rétif à la modernité, fondamentalement pessimiste, il n’a de cesse de superposer le Marseille d’aujourd’hui à celui d’hier, comme s’il était équipé de lunettes bifocales temporelles lui permettant de voir simultanément le présent et le passé. Nostalgique du monde d’avant les téléphones portables, au grand dam de sa fille, il se replonge au gré de ses pérégrinations pour localiser l’ado fugueur dans les souvenirs d’une enfance marseillaise passée sur les hauteurs de l’Estaque, loin du fourmillement et du brouhaha de son centre urbain. C’est justement dans ces interstices que l’ouvrage tient toutes ses promesses, quand le ressenti prime sur une intrigue aux contours bien définis et lorsque la poésie s’immisce par petites touches douces et légères à l’évocation, par exemple, d’une grand-mère aimante ou d’un goûter composé de pêches à la crème.
Un premier roman prometteur qui confirme que de la musique à l’écriture, il n’y a parfois qu’un pas… À n’en pas douter, Pascal Escobar en a encore sous le cuir.
Emma Zucchi
À lire : Belle de Mai de Pascal Escobar (Le Mot et le reste)
