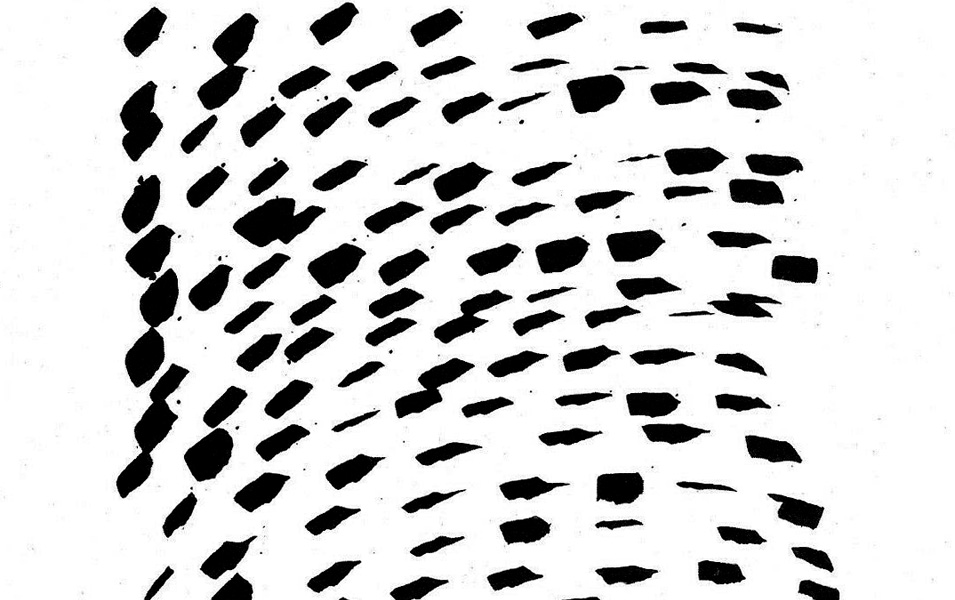
La Semaine perpétuelle de Laura Vazquez
L’entretien
Laura Vazquez
Lauréate du Prix Wepler mis en place par la Fondation La Poste depuis 1998, Laura Vazquez nous présente son premier roman, La Semaine perpétuelle, publié aux Éditions du sous-sol. Partant d’un récit familial, elle fait renaître un monde à la manière d’une toile, inspirée des relations que crée internet, omniprésence qui nous suit à travers le texte. Un livre écrit comme une poésie, son genre initial, dont la sincérité nous a intrigués au point de vouloir en savoir plus. Retranscription de cette rencontre épistolaire.
Vous publiez La Semaine Perpétuelle aux éditions du sous-sol. Pourquoi avoir choisi ce titre ?
Je ne l’ai pas vraiment choisi. Il est venu comme par lui-même vers la fin du livre. Mais il y a dans ce livre et dans la vie des choses qui se répètent perpétuellement — il est beaucoup question de nos rapports au temps dans ce texte. De manière plus littérale, simplement la temporalité du récit tient dans une semaine. Et j’aime qu’il y ait une sorte de résonnance assez lointaine avec la prière, à travers la notion d’adoration perpétuelle. Je crois que c’est Tarkovski qui disait que toute forme d’art est une prière. Kafka aussi disait ça.
Co-fondatrice de la revue poétique Muscle, vous avez également publié plusieurs recueils de poèmes. Qu’est-ce qui vous a poussée à vous attaquer à la forme romanesque ?
Ce qui m’y a poussée, une force obscure peut-être, non je rigole, une force lumineuse peut-être, non je rigole… Comme tous les humains, j’aime les histoires, je voulais des vies dans mon livre. Et j’ai appris, lentement, à faire quelque chose de moins impulsif que par le passé, quelque chose qui demande beaucoup de patience et d’épreuves de foi. J’ai passé environ quatre ans à écrire ce livre et j’ai traversé différentes périodes ; j’ai vieilli et les romans et les poèmes sont au fond la même chose pour l’écriture.
Comment est né ce roman ? Quel a été votre processus d’écriture ?
Je ne vois pas les choses sous forme de processus. Il y a une continuité dans l’écriture. Ce roman est terminé depuis longtemps, mais l’écriture continue pour moi, cette relation ne cesse pas, elle ne change pas du tout au tout. Aussi, je n’ai pas de processus, mais peut-être des rythmes, des phases, des moments de compréhensions.
Pour La Semaine perpétuelle, j’ai passé au moins un an et demi à aller dans la mauvaise direction, celle de la force, puis j’ai laissé. Et j’ai ressenti l’impuissance comme la voie la plus libératrice et la plus juste au moment d’écrire.
Une fois que j’ai été vaincue, je suis devenue humble, et c’est tout ce qu’il fallait.
Alors le livre a commencé. Ensuite, les étapes sont aussi banales qu’on l’imagine : lecture, relecture, lecture, relecture, correction, modification, lecture, relecture, et comme ça pendant des années.
Le travail de l’oralité est très important dans votre carrière de poétesse. On a notamment pu voir des lectures vidéo de vos ouvrages pendant le confinement, ainsi que des projets de création à plusieurs voix avec d’autres poètes. Votre écriture est d’ailleurs empreinte de matière, de texture, de mouvement et même d’une certaine violence. Comment avez-vous travaillé cette question de la langue dans ce roman ?
Ce qui pour moi va au plus loin, au plus mystérieux, c’est l’écriture. Ça se trouve dans les textes, dans les pages, les phrases. C’est vrai, j’ai fait beaucoup de lectures, des vidéos aussi plus jeune, mais c’est très petit comparé à ce que je ressens dans l’écriture. Ce qui touche à un grand sentiment commun, je sens que je m’en rapproche dans l’écriture, dans les livres. Je m’intéresse moins aux lectures, à l’oralité, en tout cas pas telle qu’elle est présentée en Occident, sans doute pas dans cette histoire.
Vos ouvrages ont été massivement traduits en plusieurs langues : chinois, anglais, espagnol, portugais, norvégien, néerlandais, allemand, italien et arabe. Certaines vous ont-elles inspirée ? Pensez-vous que la poésie a un côté universel ?
Quelques textes ont été traduits dans plusieurs langues et quelques livres aussi. Ces traductions me réjouissent bien sûr, mais pour ce qui se passe quand j’écris, elles ne jouent aucun rôle.
Ce que ça change concrètement, c’est l’apparition de rencontres dans ma vie. J’ai rencontré des personnes qui traduisent et parfois nous discutons, ce qui est bien.
Vous me demandez si la poésie a un côté universel. Réponse : oui. Elle a un côté de tous côtés.
Sur votre site internet, on peut voir un extrait d’une œuvre médiévale. Cette période vous fait-elle écho ? Vous parlez également de votre goût pour le rap. Quelles sont vos autres sources d’inspiration ?
Oui, le Moyen-Âge est une période que j’aime bien, pour plusieurs raisons. L’une d’entre elles est qu’en ce temps-là, le monde était encore inexploré. Alors souvent dans les œuvres médiévales, on trouve des êtres extraordinaires, des scènes incroyables et, en général, tout avance rapidement. Et puis les animaux sont placés sur le même plan que les humains, et certains éléments de la nature comme les roches, les plantes, le ciel, ont des rôles dans les récits ; ils agissent, prennent des décisions, c’est quelque chose qui m’intéresse beaucoup. J’ai d’ailleurs traduit un lai de Marie de France il y a quelques années, et nous l’avons publié dans la revue Muscle. J’aimerais traduire encore des textes médiévaux.
Pour le rap, c’est la musique que j’écoute au quotidien ; je ne sais pas s’il y a un rapport direct avec l’écriture, je n’en suis pas sûre. S’il y a un lien, il se trouve peut-être dans les aspects : confidence d’une voix, narration à la première personne, atmosphères, son de la pluie en arrière-plan, répétition-variation d’un motif simple, changement de thème ultra-rapide d’une ligne à l’autre.
Ensuite, pour ce qui est des autres sources d’inspiration, elles sont multiples, j’aime croire que je prends tout partout. Quelques-unes des choses qui peuvent m’aider pour mes textes en ce moment : les radiographies de parties du corps et du corps entier, les livres d’étude mystique et philosophique, la cuisine japonaise, la manière dont se forment les fœtus et toute forme de vie, les textes chinois anciens à propos des légumes à racines, l’organisation hebdomadaire des mères au foyer trentenaires…
Les dialogues prennent une place particulière dans votre livre. En tant que lecteurs, nous suivons ce fil où se mêle une grande part de subjectif, et qui semble pleinement ancré dans la réalité. Comment les avez-vous pensés ?
Je ne les ai pas vraiment pensés, étonnamment ils sont arrivés. Je n’imaginais pas du tout écrire des dialogues, mais les voix se sont mises à parler et à se répondre, et l’écriture a trouvé des mouvements très dynamiques comme dans un système de fils qui se croisent, se mêlent et rebondissent. L’écriture s’y est, si je puis dire, épanouie. Elle s’est ouverte, elle s’est amusée. Ça donne lieu à des passages qui m’ont beaucoup fait rire. Le rire arrive souvent par hyper-dynamisme, sortes de zigzags rapides et bondissants (ici dans l’écriture, mais c’est sans doute valable ailleurs), j’en ai fait l’expérience.
Vos personnages, notamment celui de Salim, s’adressent à nous quasiment exclusivement par le biais d’Internet. Pensez-vous qu’il existe une langue propre à ce médium ?
Non, je ne pense pas. Comme dans chaque espace, il y a des sortes de références communes, mais il n’en est pas question dans le livre. Ce n’est pas un livre de communauté. Ce qui compte, ce sont les voix. Dans ce livre, certaines viennent d’Internet, mais elles pourraient aussi bien venir d’une grotte ou d’un sous-terrain, ce serait la même chose.
Marseillaise d’adoption, avez-vous un rapport particulier avec cette ville, et si oui, son imaginaire, sa langue ou son histoire ont-ils nourri votre écriture ?
Oui, Marseille est importante pour moi, j’y vis depuis longtemps maintenant, j’y ai des ami.e.s, des proches, des lieux préférés, c’est une ville que j’aime, autrement je n’y vivrais plus. J’ai la chance de vivre dans un quartier très calme, mais je n’ai qu’à faire quelques pas pour entendre des conversations et pour voir un peu de monde, c’est très pratique, il y a toujours des surprises par-ci, par-là, bonnes ou mauvaises. Et, bien sûr, la lumière.
Vous intervenez dans de nombreux ateliers d’écriture, notamment au cipM. Pouvez-vous en dire plus sur les projets que vous menez avec le public ?
J’ai donné beaucoup d’ateliers d’écriture en médiathèques, des masterclasses à l’université et des workshops en école d’art. Mais depuis quelques années, je donne surtout des cours d’écriture créative en ligne, sur Internet. J’y trouve un grand plaisir.
Ces ateliers sont devenus une sorte de grande communauté. Il y a plus de 2 000 inscrit.e.s. Chaque semaine, j’envoie un atelier d’écriture par mail, et c’est gratuit. Je m’appuie toujours sur des textes (poèmes, extraits de romans, de nouvelles) que je partage et que je commente puis, à partir de là, je donne un axe d’écriture. Ensuite, les participant.e.s partagent leurs textes sur un groupe privé. C’est très vivant, très beau. Nous avons un compte Instagram si ça vous intéresse : les ateliers d’écriture.
D’après vous, à quel moment a-t-on le sentiment qu’un roman est terminé ?
Ce sentiment apparait quand on sent qu’on décide soi-même. Si on décide soi-même, c’est qu’on force. Si on force, on se trompe. Il faut s’arrêter. Mais la frontière est fine entre trop tôt et trop tard. Souvent, on va un peu trop loin.
Vos futurs projets d’écriture ?
J’écris depuis quelques années une épopée en vers.
Ce sera un livre de poésie, très long, dans lequel on trouvera des voix, des lieux, des recherches, des atomes, et, comme dans toutes les épopées, aucune réponse.
Propos recueillis par Laura Legeay
Dans les bacs : La Semaine perpétuelle (Éditions du sous-sol)
